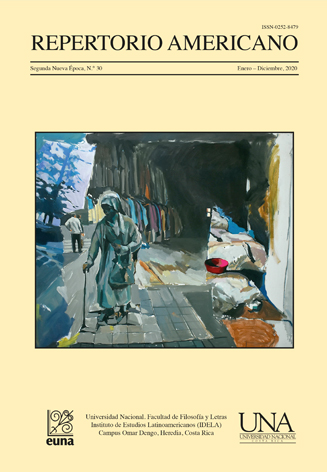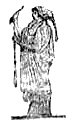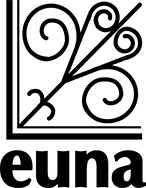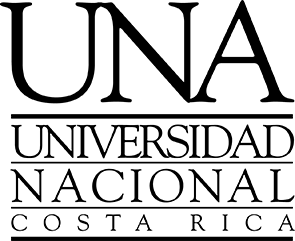R E P E R T O R I O |
| A M E R I C A N O |
Segunda nueva época N.° 30, Enero-Diciembre, 2020 | ISSN: 0252-8479 / EISSN: 2215-6143 | |
La femme dans la spirale de la violence
La mujer en la espiral de la violencia
The woman in the spiral of violence
Virginia Borloz Soto
Escuela de Lenguas Modernas
Universidad de Costa Rica
“Vaste est la prison qui m’écrase,
D’où me viendras-tu délivrance?”
Chanson berbère
|
Resumen En este artículo se pretende mostrar que la literatura de la escritora argelina Assia Djbar se mueve en un contexto de violencia que se manifiesta en el texto por medio de actos lingüísticos históricamente comprobables y que apuntan a la mujer como blanco de la violencia masculina. Teniendo en cuenta la noción de pluriculturalidad propia de la francofonía y de la importancia de la escritura para la mujer marcada por una doble pertenencia, que remite a las nociones de plurilingüismo, polifonía, visibilización de la mujer, dominación masculina, ambigüedad, ironía y transgresión, se recorren y se analizan prácticas generadoras de violencia. Tomando como ejemplo una de sus novelas y por medio del análisis de actos lingüísticos que dan cuenta del estatus de la mujer argelina, de la influencia de la religión, de la dominación masculina, así como de la construcción de la identidad, se constata la violencia ejercida históricamente contra la mujer argelina en particular y contra la mujer en general y que en la actualidad hace que, en una buena parte del mundo, la mujer se mueva dentro de la espiral de la violencia. Palabras claves: Argelia, Assia Djebar, mujer, hombre, texto, contexto, violencia, subjetividad, dominación, misoginia Résumé Dans cet article on veut montrer que la littérature de l’écrivaine algérienne Assia Djebar se meut dans un contexte de violence qui se manifeste dans le texte au moyen d’actes linguistiques historiquement comprobables et qui visent la femme comme la cible de la violence masculine. En tenant compte de la notion de pluriculturalité propre de la francophonie et de l’importance de l’écriture pour la femme marquée par une double appartenance qui remet aux notions de plurilinguisme, poliphonie, visibilité de la femme, domination masculine, ambiguité, ironie et transgression, on fait le parcours et l’analyse des pratique génératrices de violence. Prenant comme exemple un de ses romans et au moyen de l’analyse d’actes linguistiques qui rendent compte du statut de la femme algérienne, l’influence de la religion, la domination masculine, ainsi que la construction de l’identité, on constate la violence historiquement exercée contre la femme algérienne en particulier et contre la femme en général et qui fait que, dans l’actualité et un peu partout dans le monde, la femme se meut dans la spirale de la violence. Mots clés: Algérie, Assia Djebar, femme, homme, texte, contexte, violence, subjectivité, domination, misogynie |
Étudier et réféchir sur la violence exercée depuis la nuit des temps contre la femme, avec le dessein de se manifester contre la régression et la misogynie, est une tâche à tout moment urgente. Pour ce faire, nous avons suivi la trajectoire de l’écrivaine Assia Djebar et nous allons nous approprier de sa parole pour dire comme elle: “J’écris comme tant d’autres femmes algériennes avec un sentiment d’urgence , contre la régression et la misogynie.” (Djebar, 1999, p.137)
Par ailleurs, nous le faisons à un moment où nous constatons la misogynie toujours existante dans le monde en général et dans notre pays en particulier. Mais nous allons dénoncer aussi à notre tour, d’une part, ce qui se joue dans l’écriture lorsque le sujet qui écrit est tourmenté par plusieurs voix, “Ces voix qui m’assiègent”, dit-elle, et lorsque la femme confère la voix et la visibilité aux autres femmes.
Dans ses écrits, Assia Djebar nous propose un regard historique basé sur la chronique et mêlé de toute la complexité de l’individu; d’autre part, elle nous montre ce que l’écriture joue, lorsque le sujet qui en subit ses effets est inculpé avant même sa propre naissance. La femme, nous le savons, a toujours été marquée par un signe, que ce soit celui du sang, de la maternité, de la beauté, de la faiblesse ou de la folie. Ils ont tous contribué à élaborer à travers le temps, un symbole de la femme comme un être issu d’une imperfection et d’un péché originel ancré dans la mémoire collective d’une empreinte impérissable.
C’est pourquoi Assia Djebar en tant qu’écrivaine, mais surtout dans sa condition de femme, concède à ses congénères non seulement le droit à la visibilité et a leurs propres voix, mais aussi à se montrer en tant qu’êtres humanins, rebelles et insoumis, libres au moins de cette marque injuste qui les abaisse et les opprime.
L’expérience de lecture d’une partie importante de ses romans devient donc un exercice d’appropriation de la parole d’autrui; et la passion qu’elle éveille à travers ses textes, nous emporte et nous séduit , mais en même temps, nous interpelle et nous perturbe.
Par ailleurs, essayer de comprendre d’autres cultures, d’autres croyances, d’autres coutumes, c’est un défi qui nous conduit vers le monde de cette femme algérienne; c’est un monde marqué para la différence entre les sexes, par la religion, et par une violence dont l’être humain, à présent, ne donne pas signe de s’en sortir. Et c’est d’autant plus frappant que ce soit ainsi, à un moment de l’histoire de l’humanité à l’aube du XXIème siècle, où le conflit Orient-Occident devient insoutenable, et les causes politiques et économiques qui déchirent le monde se déguisent toujours sous le masque des mêmes phénomènes engendreurs de violence dénocés par lécrivaine; il s’agit aussi d’un monde qui clame de plus en plus sa multiculturalité, sa pluralité de croyances et de religions, son besoin incontournable de respecter les autres et de leur exiger du respect. C’est également un monde où la notion de couple s’affaiblit et le “moi” devient plus important, parce chacun se voit une totalité en soi, ne se considérant plus comme la moitié d’un autre (Badinter, 1986). C’est un monde où l’on ne parle pas non plus de la différence de sexe, mais aussi de celle de genre, c’est-à-dire, de la manière comment chacun construit et octroie signification à ce qui a donné, dans une société en particulier, signifié aux concepts de “masculin” et de “féminin”. En définitive, Assia Djebar se réfère à un monde où l’amour et l’affectivité se libèrent de plus en plus des contraintes de la masculinité et de la féminité.
C’est ainsi que, guidés para la main de cette fleur immortelle, mais intransigeante, pour se tenir à l’étimologie en arabe du pseudonyme d’Assia Djebar (Briana Belciug, 2014), on entre dans cet autre monde créé par la littérature; et grâce à son génie et à sa plume, elle parvient à dominer un contexte dominé par l’inégalité, la soumission et la violence, en un texte nuancé par les beaux souvenirs, les opportunités et l’importance de l’instruction pour les femmes, dont elle devient le porte-parole et sa pensé devient, elle aussi, universelle. De là sa vertu, puisque:
Si la langue n’est pas nécessairement liée à la race, elle est, par contre, liée à la culture. Dans le sens où la culture signifie l’adéquation au milieu. Et j’entends par milieu, non seulement la géographie, mais encore l’histoire et la situation présente de la société: économie et politique. (Senghor, 1977, p.229)
Et c’est par cet engagement rigoureux et fidèle qu’elle atteindra, quelques années plus tard, un siège parmi les Immortels de l’Académie française comme première femme d’origine algérienne occupant cette place d’honneur; ce lauréat est d’autant plus méritoire, car du fait qu’il est déjà difficile à obtenir par les hommes, à qui toute opportunité est donnée, pour une femme et par surcroît algérienne, c’est un exploit idéniable que de l’avoir décroché.
Fatima-Zoohra Imalay, connue dans la littérature comme Assia Djebar, naît dans une famille de petite bourgeoisie traditionnelle algérienne. Son père, Tahar Malhayène, est un instituteur issu de l’École normale musulmane d’instituteurs de Bouzaréah autochtone de Gouraya. Sa mère, Bahia Sahraoui, appartient à la famille berbère originaire de la tribu des Menasser du Dahra.
Assia Djebar étudie a l’école française et à l’école coranique privée. À dix ans, elle entre au collège de Brida, en section classique ( grec, latin, anglais) et y obtient son baccalauréat en 1953. En 1954, elle est admise en khâgne (ou clase préparatoire pour l’École normale supérieure-en lettres), au Lycée Fénelon, à Paris. L’année suivante, elle initie ses études à l’École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, où elle choisit l’étude de l’histoire. À partir de 1956, durant la guerre d’Algérie, elle ne passe pas ses examens à cause des grèves des étudiants algériens. En 1958, elle publie son premier roman, La Soif. Une année plus tard, elle abandonne l’école, épouse l’écrivain algérien Walid Gran, puis elle quitte la France.
Entre 1959 et 1965, Assia Djebar étudie et enseigne l’Histoire, spécialement à l’Université d’Alger, et entre 1966 et 1975 elle voyage entre la France et l’Algérie. Entre 1995 et 2001, elle dirige le Centre d’Études françaises et francophones de Louisiane, et à partir de 2001, celles de l’Université de New York. En 1999, est élue membre de l’Académie belge. Le 16 juin 2005, est élue à l’Académie française et dans son discours d’incorporation elle fait allusion à l’importance des langues: le berbère, l’arabe et le français; cette dernière, l’énergie qui la meut à écrire.
Elle a écrit plus de vingt romans, des récits, des essais, de la poésie et des courts de cinéma, et a été traduite en vingt et une langues. De même, elle a reçu des prix et des honneurs de toute sorte jusqu’à sa mort le 7 février 2005 à Paris.
L’oeuvre d’Assia Djebar est marquée par la conscience d’une double appartenance, oscillant entre l’Algérie et la France; entre l’Algérie d’aujourd’hui et celle de la colonisation; entre le berbère qu’elle considère comme langue de souche de tout le Maghreb, l’arabe -sa langue maternelle- et le français. Dans sa narration, les aller et retour à de différentes époques, les va-et-vient des situations chronologiques différentes et les liens entre des personnages apparemment sans raport, donnent à son écriture une respiration profonde où la narratrice jouit de ces frontières spatio-temporelles créant un espace de liberté et de libération. Et non seulement elle en jouit, mais elle veut que toutes ses congénères en jouissent aussi et par conséquent, elle dénonce d’une manière véhémente la violence contre la femme.
La violence, comprise comme l’abus de la forcé physique ou psychologique, émotionnelle ou rationnelle, individuelle ou collective, personnelle ou institutionnelle, c’est un comportement humain traité à travers les plus diverses disciplines et sous des angles les plus variés. Plus particulièrement et pour le thème qui nous occupe, la violence contre la femme fait l’objet d’étude de différentes disciplines, surtout dans le siècle dernier et notamment pendant le siècle qui nous est donné de vivre où elle est même devenue l’un des points essentiels des “droits de l’homme”. Aujourd’hui on parle, par exemple, de “violence domestique”, la plupart des fois exercée par l’homme contre la femme au sein du foyer, parce que la seule situation d’oppression qui paraît être d’observance permanente est celle qui se fait en raison du sexe. Dans ce sens, nous pouvons dire que tout ce qui a été écrit à ce sujet risque de devenir inépuisable.
Nous allons donc rester fidèles à ce modèle de l’approche djebarienne, qui vise à montrer que sa littérature se meut dans un contexte de violence qu’elle parvient à transformer en texte, et qui devient à son tour métaphore et témoignage de l’histoire de la femme algérienne en particulier, et de beaucoup d’autres femmes dans le monde; en effet, c’est dans l’histoire générale et dans celle de l’écrivaine en particulier, que se trouvent les raisons de ses prises de parole en actes linguistiques.
La violence que se vit en Algérie ressemble sans doute à celle de beaucoup d’autres pays dans le mode, que ce soit en Orient comme en Occident. L’Algérie est le pays le plus grand du Maghreb ou región septentrionale de l’Afrique dont la capitale c’est l’Alger. Sa population est issue des tribus berbères, kabyles et arabes, et elle est marquée depuis ses origines par le traffic d’esclaves, la diaspora et les impitoyables guerres aussi bien entre les différentes tribus, qu’entre les autochtones et les colons français. Il y a eu de différents essais de réforme de la Constitution et des organisations dites de libération nationale. Et puis, la sanglante guerre qui s’étend jusqu’à 1962, année de l’indépendance, ainsi que l’explosion démographique qui l’a suivie, tout cumule une sorte de “violence résiduelle” qui dure à nos jours: une corruption où les protagonistes sont toujours les hommes au pouvoir et les militaires, ce qui se traduit en un mot: la violence.
Nous partons donc de ce contexte dans lequel se déroulent l’enfance et l’adolescence de l’écrivaine, pour réfléchir sur le texte qu’elle crée, en se servant de multiples fils qui se tissent à travers l’ironie et la transgression ou l’intertextualité (Kristeva, 1974). De même, nous considérons l’influence des croyances et des religions, ainsi que le concepts très importants de société patriarcale et de domination masculine, qui interviennent dans la transformation du texte écrit, où l’ambiguïté, l’ambivalence, l’ironie et la transgression jouent un rôle essentiel.
Il faut tenir compte du fait que le statut de la femme en Algérie et ailleurs, souvent, est celui de la soumission et de la subordination. Elle est sous la domination masculine car elle représente un être faible, est porteuse du péché et sujette aux goûts et aux mandats de l’homme. Pour l’histoire, elle n’a pas de voix, elle est invisibilisée, son image disparaît dans l’oubli, la veuve est échangée, la vierge donnée au vieillard enrichi, les filles violées ou offertes en butin de guerre.
En effet, issue de l’homme et créée après lui, porteuse d’un péché ou faible “par nature”, la femme est atteinte d’une marque qui, par ailleurs, ne condamne pas seulement les femmes arabes, mais aussi, et de manière identique, celles qui subissent encore aujourd’hui tout au long de la planète, le poids symbolique du pouvoir patriarcal, parce comme l’a très bien dit le sociologue Pierre Bourdieu (2002): “L’ordre social fonctionne comme une immense machine symbolique tendant à ratifier la domination masculine sur laquelle il es fondé.”
Assia Djebar, qui a fait partie d’une minorité ayant la chance d’aller à l’école, qui est née au sein d’une famille unie, respectueuse et aimante, a connu quand même, les contraintes d’une formation rigide, issue du regard masculin qui l’entourait et dont un père tolérant et une mère respectée, n’est pas parvenue à s’en échapper complètement. Son père n’a jamais accepté qu’elle monte à vélo car elle risquait de montrer ses genoux; en plus, elle n’a jamais pu approcher son frère, et le mot arabe “hannouni” -qui signifie affection ou tendresse- lui a été révélé trop tard, d’après elle. Elle devait accompagner cette femme adulte qui était sa mère au “bain maure” et est devenue presque sa protectrice.
Pour ne prendre qu’un exemple d’un roman d’Assia Djebar où l’on peut constater une des formes de violence contre la femme, issue de la réalité d’une tradition qu’elle parvient a transformer en texte littéraire plein de signification et de beauté, nous ferons référence à Vaste est la prison, un chant envoûtant et à la fois brutal au mariage forcé que la tradition impose à la femme algérienne. La violence qui en résulte s’y exerce aussi bien du point de vue physique qu’émotionnel et psychique.
De la grand-mère en jeune épousée: elle est donnée en mariage, à quatorze ans, par son père -quarante ans , celui-ci, guère plus- à un vieillard, l’homme le plus riche de la ville, et elle est devenue sa quatrième épouse ( ) Quinze ans avaient suffi pour qu’elle changeât de rôle, qu’elle n’attendit plus le coeur battant en idole, qu’elle devienne la servante, la cuisinière aux fourneaux; oui, le même soir, le même sourire de l’homme, sa même entrée comme aujourd’hui, et soudain-soudain un long cri, suivi d’un silence de toutes (trop tard, le marié a fermé la porte sur son hyménée). Et elle, la première, elle s’abat de tout son long, pratiquement sur le seuil de l’office ( ) On l’emporta tout de même, huit jours après, morte…(p.213)
C’est l’histoire des femmes arabes pour qui le mari est nommé l’ennemi, ce qui provoque en nous, en tant que lectrices, non seulement un grand étonnement, mais un vrai bouleversement. Et c’est aussi une manière de constater les effets du “pacte autobiographique” dont nous parle Philippe Lejeune, pour qui ces effets sont issus d’un contrat implicite ou explicite auteur-lecteur en tant que déterminant du mode de lecture du texte. Nous y trouvons les rituels propres du mariage, souvent entre un homme âgé, parfois même vieillard, avec la jeune vierge de son choix ou de celui des convenances entre familles. Il y a aussi le hamman ou salon des baigneuses, un lieu de réunion et de rencontre féminines, où un après-midi constitue l’événement de la semaine, quoique chacune d’entre elles encombrée d’une troupe d’enfants; en outre, nous sommes devant une histoire d’antiquité et de modernité, d’amour et de haine, d’acceptation et de rejet. C’est un roman particulièrement violent qui provoque les sentiments les plus contradictoires, car il ne s’agit plus d’ambiguïté: ici, il est question de noir et blanc, de paradoxe total, d’un monde à part pour les hommes et un autre pour les femmes.
Le mot, l’e’dou, que je reçus ainsi dans la moiteur de ce vestibule d’où, y débouchant presque nues, les femmes sortaient enveloppées de pied en cap, ce mot “d’ennemi”, proféré dans cette chaleur émolliente, entra en moi, torpille étrange; telle une flèche de silence qui transperça le fond de mon coeur trop tendre alors. En vérité, ce simple vocable, acerbe dans sa chair arabe, vrilla indéfiniment le fond de mon âme, et donc la source de mon écriture ( ) ce fut là le don de l’inconnue dont la voix me tarauda. Par elle la langue maternelle m’exhibait ses crocs, inscrivait en moi une fatale amertume. (Vaste est la prison, p. 14-15)
Nous constatons comment la narratrice déconstruit constamment son vécu pour essayer de reconstruire son histoire; et le discours s’avère brutal, d’une violence surchargée de douleur et en même temps d’impuissance. Ce mari ennemi rend cruelle, voire perverse, la relation homme/femme et c’est dans ce combat que l’écrivaine se définit et se projette. Mais c’est aussi en subissant la violence qu’elle réussit à accéder à son soi, et ce faisant, aux autres femmes. Et c’est en transformant le texte de cette lecture qu’elle fait de la réalité, qu’elle parvient à créer son nouveau texte. Elle recourt encore une fois à son imaginaire pour supplanter le réel, et l’ennemi devient donc l’Aimé, l’autre, celui avec qui elle partagera son rêve, et après ses retrouvailles.
Je le quittais pour rentrer chez moi dîner “en mère de famille”, disais-je, comme si m’attendais là-bas un autre rôle ou on sortait à quatre, entre amis, avec mon époux, et je dansais (Vaste est la prison, p. 53)
Et elle revient plus loin à cette idée, lorsqu’elle s’écrie:
J’ai dansé. Je danse encore depuis cet instant, me semble-t-il. Dix ans après, je danse encore dans ma tête, en dormant, en travaillant, et toujours lorsque je me trouve seule. (Vaste est la prison, p. 61)
Par ailleurs, la danse est présente dans les romans d’Asssia Djebar presque comme un rituel de découverte de la sensualité. Que ce soit dans les tribus anciennes, dans les enceintes privées ou les fêtes entre femmes d’autrefois, la danse a toujours représente pour la femme un moyen de libération et d’invention de soi.
En plus, la prison dans ce livre renvoie à la maison comme espace de permanence pour la femme algérienne; certes, mais elle fait allusion aussi à l’Algérie dans toute son étendue, car pour l’écrivaine l’horizon d’attente est brisé entre passé et présent; il s’entremêle avec les événements vécus dans son propre pays et les aller-et-retour au-delà des frontières, entre le silence et l’invisibilité de ses aïeules et les possibilités qui l’entraînent, elle, femme algérienne d’aujourd’hui, vers l’indépendance, la liberté et la modernité.
De cette manière, l’intertexte et la transgression manifestes lui permettent même de s’éloigner des conventions qui régissent sa culture et sa religion, et moyennant une reconstruction de l’ennemi qu’elle transforme en “Aimé”, elle parvient à créer une figure idéale, fantomatique qui la fait franchir l’infranchissable, c’est-à-dire l’amour éprouvé et l’adultère.
Et puis la violence conjugale, la sanction religieuse et la répudiation constitueront ainsi la réponse à ses revêries, à ses comportements idéalisés, à ses actes linguistiques faisant partie d’un contexte qui relie passé et présent, et qui dénude la généalogie d’une société patriarcale traditionnelle où le silence, l’invisibilité, la négation et le manque de liberté sont les marques indélébiles des femmes.
Dans Vaste est la prison, la mémoire féminine et la tradition orale jouent un rôle essentiel et ouvrent la possibilité à la narratrice de se lancer dans un quotidien où la révolte individuelle constitue la possibilité de construction d’une nouvelle voie vers un peu plus d’indépendance et de liberté pour toutes les femmes.
Évidemment, l’imaginaire se nourrit de la réalité ou du contexte et celui-ci de la religion, des croyances et des traditions, mais aujourd’hui il existe une certaine conscience par rapport au fait que penser le monde dans l’idée d’une seule religion ou la religion en tant que conception unique du monde, serait non seulement illusoire, mais théoriquement et scientifiquement contestable:
L’histoire d’une religion sera toujours étroite, supersticieuse et fausse; il n’y a pas de vérité que dans l’histoire religieuse de l’humanité( ), la Science sans espoir et la Religion sans preuve, s’élèvent l’une contre l’autre et se défient sans pouvoir vaincre. (Schuré, 1992)
Cependant, pour les saintes écritures, la femme a été créée à partir de l’homme, et aussi bien dans l’islamisme que dans le christianisme, Dieu et les prophètes sont des hommes et ce sont ces derniers qui ont interprété la parole divine. Ainsi, compte tenue des mots sacrés, l’homme s’est emparé de toute sorte de droits sur la femme. Dans les mots de Briana Belciug:
Épouses consentantes ou non d’un seul mari, concubines, esclaves, victimes de l’inceste ou offertes comme butin de guerre, objet qui s’offre et qui s’accepte si l’homme le veut, tout est dit dicté par Dieu et interprété par les hommes. Les jeunes filles effleurées par un vieillard, devient courant, ainsi que de trouver des récits dans des sources diverses, faisant allusion aux expéditions du Prophète pendant lesquelles il pouvait tomber amoureux d’une jeune fille et se marier avec elle par l’appel impétieux du désir “qui brûlait son corps.” (2014, p.73)
Nous constatons encore une fois que les femmes et les hommes sont déterminés par un signe: celui qui leur est conféré par la biologie. De ce fait, les uns comme les autres sont inhibés de construire librement un genre en accord avec d’autres pulsions que celles d’une marque depuis leur naissance. Et c’est aussi à partir d’un tel contexte que les êtres humains ont construit leur subjectivité, compte tenue d’une perception du monde basée sur des opposants: une subjectivité masculine et une subjectivité féminine, ce qui explique en partie la différence entre la perception masculine et la perception féminine de la violence.
Pour certains, nous dit E. Badinter (1986) que l’image poétique d’Edgar Morin de “l’homme redressé l’arme haute et de la femme courbée sur l’enfant”, est toute relative. Pourtant, c’est une image qui est passée par de différentes périodes d’acceptation ou de refus, depuis les cultures les plus anciennes et les plus diverses études scientifiques, et des spécialistes en sciences humaines dans les derniers temps.
Ceci dit, il faut reconnaître que “l’habitus”, dont nous parle Bourdieu en faisant référence au langage et au pouvoir symbolique, c’est-à-dire les résidus ou le sédiment, sorte de rouille, qui s’ancre dans l’inconscient collectif par rapport à certaines images transmises de génération en génération et qui devient un allié indéniable de la logique des contraires qui bouscule depuis toujours les rapports homme-femme, fait évident encore en 1964 dans une liste dressée par Anne-Marie Rocheblave-Spenlé, faisant partie d’une recherche sociologique sur les stéréotypes masculins et féminins, citée par Badinter (1986, p.159), basés sur les contraires: fort-faible, intelligent-impulsif, raisonnable-intuitif, actif-passif, dessus-dessous, etc.
On ne saurait pas nier, à partir de cette liste et d’autres qui lui ressemblent, que l’image qui s’en dégage est clairement déséquilibrée concernant les “plus” pour l’un et les “moins” pour l’autre, ce qui justifierait ou renforcerait les convictions sur les dites différences “naturelles”. Mais les plus et les moins, étant comme ils le sont, des signes mesurant la quantité, ceux qui visent la qualité n’en sont pas pour autant moins importants; bien au contraire, il se peut qu’ils deviennent décisifs par rapport à la perception du monde, la manière de le concevoir et le penchant perçu par la suite comme naturel de l’homme, comme la force, le combat et la violence. Et l’on tient à l’usage que Bourdieu (2001) fait des “habitus” tel qu’on l’a signalé ci-dessus et qu’il définit plus concrètement comme:
l’ensemble de dispositions qui portent les agents à agir et à réagir d’une certaine manière. Les dispositions engendrent des pratiques, des perceptions et des comportements qui sont réguliers sans être consciemment coordonnés et régis par aucune règle. Les dispositions qui constituent les habitus sont inculquées, structurées, durables: elles sont également génératives et transportables.
De sorte que, parmi maintes dispositions, celle ordonnant que “les hommes ne pleurent pas”, pour n’en citer qu’une des plus répandues, modèle les comportements, les perceptions et les pratiques qui vont endurcir l’homme et l’orienter vers la violence.
Néanmoins, suivant la logique bourdieusienne qui établit un lien fondamental entre les actions et les intérêts, entre les pratiques des agents et les intérêts qu’ils poursuivent, on peut en déduire nettement le désir pour la subordination et la répression contre la femme depuis les interprétations des écritures sacrées des diverses religions, puisque comme on le sait, la famille selon ces interprétations est:
endogamique, patrilinéaire, patriarcale, élargie et polygame Le père comme le Dieu qu’il adorait, avait tous les droits sur les hommes et les femmes de sa maison. Dans certaines circonstances, il peut vendre ses enfants ou les offrir en sacrifice. (Badinter, 1986)
Par conséquent, on peut en déduire que c’est cette réalité du vécu qui encourage l’homme dans une perception de la violence qui s’avère nuisible aux autres et à lui-même. Dû au fait que tous les excès lui ont été permis, toutes les exigences lui sont aussi remplies, voire les abus justifiés, la femme a été historiquement perçue comme un être passif et faible et s’est convertie dans la cible de la violence de l’homme. Cette violence et cette perception ont été encouragées par une supériorité inculquée, héritée des “dits” ou des lois dictées par la religion et par la société.
Il y avait eu dans nos villes, pour moins que cela, de nombreux pères ou frères devenus “justiciers”; le sang d’une vierge, fille ou soeur avait été versé pour un billet glissé, pour un mot soupiré derrière les persiennes, pour une médisance. (L’Amour, la fantasia, p.21)
C’est donc à partir de ces données que l’homme se sent contraint à construire son identité, qui représente à son tour, un processus extrêmement complexe l’entraînant à se fixer dans des “images de soi” multiples et contradictoires. Et pour mieux comprendre ce processus, nous retenons ici l’idée de Jean-Claude Kaufmann qui va servir à nous éclaircir cette différence essentielle entre les images de soi qui ne sont que de simples reflets imaginaires et le processus identitaire, “alors que l’individu est un processus dynamique et ouvert, insaisissable, vivant au milieu de milliers et de milliers d’autres images” (Kaufmann, 2004). C’est ainsi que pour l’homme, l’image de la guerre devient primordiale, liée, en outre, au sang, aux désirs et aux refoulements acharnés.
Pélissier “le barbare”, lui, le chef guerrier tant décrié ensuite, me devient premier écrivain de la première guerre de l’Algérie! Car il approche des victimes quand elles viennent à peine de frémir, non de haine mais de furia, et du désir de mourir Pélissier, bourreau-greffier, porte dans les mains le flambeau de mort et en éclaire ces martyrs. (L’Amour, la fantasia, p.92)
Et comme ce bourreau-greffier prêt à laisser la trace de son regard et dans sa tâche particulière de fonctionnaire, chaque homme vit et subit la violence, compte tenue de sa perception individuelle pour conformer, somme toute, une perception masculine de la violence, assez généralisée, perçue comme négative et nuisible pour la bonne convivialité.
Ceci dit, et étant donnée l’ancestrale séparation des sexes basée sur la division des rôles, nous voici revenus aux liens cruciaux entre rôles et identité; car, malgré l’intéraction inévitable des symboles qui poussent la structuration des identités sur des images ou des modèles fixés par les rôles sociaux, tout individu est doté d’une subjectivité, élément central dans le domaine identitaire, articule les extériorités qu’il rencontre. Le rôle, par contre, n’étant qu’une identité particulière à un moment donné, mais souvent même institutionnalisé, agit sur le social dans une vaste diversité de contextes et sous des poids différents du passé social, les croyances et la religion parmi les plus lourds. L’identité, nous dit Kaufmann (2004), singularise et unifie l’individu, crée un univers symbolique, bricole les liens, construit l’estime de soi tout en produisant l’énergie nécessaire de l’action.
De cette sorte, si l’on compte des études consultées sur la construction du soi, la quête du sens de la vie et la place grandissante de la subjectivité dans la reproduction sociale, on est susceptible de voir dans ce processus complexe et plein de conflit, les causes qui expliqueraient les “dispositions” assumées par de différentes cultures inclinant l’homme vers des comportements plus ou moins penchés sur la violence, une violence, par ailleurs, qui ne s’avère pas toujours physique, mais psychologique et émotionnelle aussi. Dans Vaste est la prison, l’écrivaine proteste contre cette violence, lorsqu’elle s’écrie:
Explique-moi, Lalla, comment le père de l’adolescente, ce Ferhani, ce mokkadem, dis-tu, de quarante ans, décide de donner ainsi sa fille si jeune à un homme qui pouvait être plus vieux que son propre père à lui! (p.206)
Dans notre contexte, nombreuses sont les écrivaines qui font référence à la violence contre les femmes, une violence propre aussi à une société patriarcale et machiste comme la nôtre. Pour n’en citer que certaines parmi elles, Carmen Naranjo (Costa Rica, 1928-2012) dans son recueil de contes Nunca hubo alguna vez (1984), trasmet la colère dissimulée de la fillette qui se déguise en clown parce que les clowns, tout le monde les aime. En se camouflant, elle répond à l’observation de sa mère, pour qui, par le seul fait d’être femme, elle est déjà “un clown” et elle le fait de même à l’explication de son père, qui estimait que les femmes clown n’existent pas puisque personne ne paierait pour les voir, car d’après lui, elles se maquillent, elles se déguisent et marchent partout dans les rues et dans les parcs.
Se déguiser, se dissimuler, se cacher sont tous les mots servant à caractériser l’attitude de la femme, parce que comme le dit aussi l’écrivaine costaricienne Yadira Calvo (1941) dans son essai Literatura, mujer y sexismo (1984), dissimuler c’est le seul comportement non controlable, c’est l’arme secrète de l’opprimé qui ne peut pas parler, lutter ni participer. Toujours dans cette même ligne, Ana Istarú (Costa Rica, 1960), dans son poème “Les hommes aiment les couteaux” (2015), s’écrie:
Ils imbibent leurs couteaux dans la cendre
en écoutant la haine, sa racine
qui a poussé dans l’entraille
comme une étoile amère
très aiguisé soudain impitoyable
Ils aiment les couteaux
La mort dessine
ce dur éclair
et dans leurs mains le pose
efface la caresse, les adieux, les mouchoirs.
Tout au long de ces vers, elle nous présente ces images presque universelles de violence et de brutalité frappantes, mais pas pour autant moins néfastes pour l’humanité. L’emploi et le choix du vocabulaire reflètent un état d’agression constante de la part des hommes: ils aiment les couteaux, symboles d’agressivité; la haine pousse dans la profondeur des entrailles et leurs couteaux sont prêts à accomplir leurs tâches impitoyables menant vers la mort.
De cette manière et pour revenir au contexte d’Assia Djebar, nous pouvons constater comment elle partage avec les écrivaines costariciennes C. Naranjo, Y. Calvo et A. Istarú la même perception concernant la subjectivité masculine ayant une disposition pour la violence. Elles ne doutent nullement que la plupart des hommes naissent et sont endoctrinés dans une ambiance propice pour faire perpétuer les idées de suprématie qui leur ont été léguées de génération en génération, et en même temps pour faire valoir cette prétendue supériorité masculine en détriment de l’intégralité féminine.
En ce qui concerne la perception féminine de la violence, nous avons pris comme point de départ la même image de Morin, cité par rapport au couple -“l’homme redressé l’arme haute et la femme courbée sur l?enfant”- qui a parcouru l’histoire depuis longtemps. Nous avons aussi tenu compte de la “logique des contraires” ancrée dans la mémoire de l’humanité et qui a été l’objet d’études les plus diverses des différentes sciences, aussi bien naturelles que sociales. Dans ce cadre, la sujectivité de la femme a été forcée de se construire suivant les plus strictes règles du silence, des interdits, voire de l’invisibilité, c’est-à-dire, dans le refoulement et dans la souffrance.
Réduite par l’autre à des critères qui la fixent à jamais dans des images arbitraires élaborées selon des rôles assignés, la femme subit la violence, comme victime passive et de ce fait sa perception n’en résulte pas objective, “car les structures de pensée dominantes s’imposent aussi aux dominés” (Bourdieu, 1998) et les sédiments qui s’y ancrent, les font paraître, même, des complices. De cette manière, le procesus de construction de l’identité, dynamique, ouvert et insaisissable dont nous parle Kaufmann (2004), visant à l’estime de soi et à la découverte du sens de la vie, chez la femme n’atteint pas son développement de la même façon que chez les hommes. Elles deviennent ainsi dominées par leur domination, une domination qui s’avère, en outre, non seulement légitimée et institutionalisée, mais presque généralisée dans le monde actuel.
Bien entendu, l’Algérie n’en est point d’exception, bien au contraire, l’exemple berbère constitue un point de départ indéniable dans l’étude et l’analyse des sociétés androcentriques d’hier et d’aujourd’hui. C’est pourquoi nous avons trouvé pertinent de faire référence à l’entretien soutenu par Catherine Portevin à Pierre Bourdieu à propos des différents sujets concernant les stéréotypes qui ont favorisé la domination masculine; parmi ceux-ci, il y a deux cérémonies qui marquent à jamais les oppositions des rôles entre les hommes et les femmes. Dans la cérémonie de la mort du cochon, les hommes jouaient un rôle bref, spectaculaire, ostentatoire:
Ils poursuivaient le cochon, ils portaient le coup de couteau, ça criait, le cochon gueulait, le sang coulait Et puis après les hommes se reposaient, jouaient aux cartes pendant deux jours tandis que les femmes s’affairaient à découper, fabriquer des boudins, les saucisses, les saucissons, les jambons. Comme en Kabylie, pour la cueillette des olives, l’homme arrive avec une grande gaule, symbole masculin, il frappe les branches, acte bref, masculin, ça dure dix minutes, et ensuite la femme et les enfants ramassent les olives sous le soleil des journées entières. De cette opposition entre le haut et la bas, le spectaculaire et le minutieux découlent des tas de préjugés (Bourdieu, 1998)
Et c’est bien à partir de ces rôles toujours attribués par l’autre, imposés par autrui et qui se répètent à l’infini et dans les différents confins de la Terre, que le regard, la perception de l’autre, devient regard qui affronte, regard qui oppose; il s’agit toujours des contraires , toujours les oppositions, et on se demande donc avec l’écrivaine:
qu’est-ce que le ragrd de l’autre sur la femme dans une culture où l’oeil d’abord a été, des siècles durant, mis sous surveillance, un oeil unique existait, celui du maître du sérail qui interdisait toute autre représentation et qui invoquait le tabou religieux pour convoquer son pouvoir? (Ces voix qui m’assiègent, p.163)
Certes, comme le dit Assia Djebar, devant l’interdiction de toute “autre représentation”, quelle pourrait être donc la perception féminine de la violence, sinon celle qui lui a été imposée? La femme a été victime de sa propre culpabilité inculquée depuis sa naissance et qui se trouve ancrée dans sa mémoire. D’après l’habitus qui dicte des dispositions largement établies, la violence subie devient presque consubstancielle à sa condition de femme; son comportement en tant qu’opprimée conforme aux commandements des oppresseurs, la rendent aliénée dans la mesure où elle transfère sa conscience réceptrice en porteuse de la conscience de l’oppresseur.
En Algérie, comme dans beaucoup d’autres pays, la scolarisation tardive des filles a favorisé aussi le retardement de la prise de conscience de l’importance pour les femmes de se rendre libres de l’influence familiale. La perception de la violence, pour la femme en général et pour l’algérienne en particulier, devient donc un processus difficile à mener, la faisant victime et complice à la fois. Il est nécessaire de rappeler la sentence de Rousseau -le grand philosophe de l’éducation au XVIIIème siècle- assez dépassée mais pourtant non pas complètement disparue: “ce qu’elle doit apprendre, avant tout, c’est à subir jusque l’injustice et à savoir supporter , sans se plaindre, les offenses de son mari” ( in Yadira Calvo, 2009, traduit par VBS).
Dans ce processus, Assia Djebar incarne non seulement la fille algérienne scolarisée de la vie réelle, qui a connu le privilège d’être née dans une famille lui permettant de s’instruire et d’enrichir son esprit malgré les codes stricts de la société que son père s’est vu forcé à respecter:
C’est à cause de ce public d’hommes de sa communauté (journaliers, artisans, chômeurs) qu’il ne tend plus la main. Un homme arabe, père de famille, doit marcher seul, son regard posé sur ses enfants (en général mâles, mais je suis l’exception) et avançant, lui, comme un vrai “chef”, d’un pas tranquille. (Nulle part dans la maison de mon père, p.100)
Mais Assia Djebar représente aussi la femme capable de saisir l’ampleur de la tragédie des autres femmes algériennes d’autrefois et d’aujourd’hui, de ses congénères, de ses proches, des connues et des iconnues. Elle a aussi non seulement à se faire une autre image, mais à créer ses propres personnages, des femmes révoltées, des femmes chez qui “il s’agit d’une révolte contre la famille traditionnelle et les règles imposées par la société arabo-musulmane” (Briana Belciug, 2014).
Car il s’agit bien d’une “autre représentation”, un autre regard sur la femme par la femme et d’une autre perception de la violence pour la dénoncer, pour crier la souffrance et le désespoir des femmes blessées par les violences vécues, subies, intériorisées, et par la violence qui fait mal à soi-même et aux autres, par toute sorte de violence contre les femmes qui dure depuis toujours et qu’il faudrait cracher sur l’humanité pour qu’elle réagisse.
Devant un tel tableau blanc, les textes d’Assia Djebar persistent à demander: Combien de femmes faut-il encore sur l’autel du sacrifice? Il suffirait de consulter les chiffres sur la maltraitance domestique, sur les filles prises comme butin de guerre, sur les violations sexuelles, sur l’esclavage sexuel, sur l’ablation du clitoris dans beaucoup de pays, sur les maurtres par jalousie, sur l’emploi abusif de l’image de la femme dans la publicité, sur la paie inégale pour des travaux pareils ou mêmes professions, sur la prostitution des femmes, où l’argent devient intermédiaire sournois entre le pouvoir masculin et les besoins féminins. Tout ceci parmi les agressions les plus évidentes, mais non pas les seules. Ne sont-elles pas suffisamment représentatives de ce dont la femme doit se nourrir au jour le jour pour pouvoir survivre anéantie en tout domaine, et pour se faire une perception de la violence différente de celle de l’homme? Et ce n’est pas que d’être pessimiste, comme le dit Bourdieu, que de montrer “combien sont profondes les racines de l’opposition masculin/féminin. Elle est liée à toutes les oppositions fondamentales sur lesquelles reposent notre éthique et notre esthétique” (1998).
Et encore une fois, c’est une éthique évidemment conçue et dictée par les hommes et à leur mesure, dont Assia Djebar illustre incessamment ses créations:
À onze ans, je partis en pension pour le cursus secondaire. Qu’est devenue la fille du boulanger? Voilée certainement, soustraite du jour au lendemain aux chemins de l’école: son corps la trahissait. Ses seins naissants, ses jambes qui s’affinaient, bref l’apparition de sa personnalité de femme la transforma en corps incarcéré! (L’Amour, la fantasia, p.207)
Et une esthétique construite dans le même sens , compte tenue de la violence génératrice contre les femmes.
Par ailleurs, Virginia Wolf (1882-1941), dans son célèbre réflexion sur la maltraitance des femmes nous fait savoir qu’ “il est nécessaire d’avoir cinq cents livres de rente et une chambre dont la porte est pourvue d’une serrure, si l’on veut écrire une oeuvre de fiction ou une oeuvre poétique” (Une chambre à soi, www.wordpress.com, 28-10-17).
Voilà ce que c’est qu’une perception de la femme par la femme et ses besoins pour franchir les frontières de la violence en général et pour stopper les dardes de l’agression masculine en particulier: il lui faut de l’indépendance économique et un espace d’action propre. Pour le reste, la construction du soi et d’une identité en accord avec ses caractéristiques spécifiques, font partie du processus complexe de construction d’identité inné à tout être humain, que ce soit homme ou femme.
Or, c’est dans ce sens que les récits djebariens convoquent les femmes algériennes en particulier, et en elles toutes les femmes, pour les transformer en figures à la fois vivantes et allégoriques, en composantes d’une narration dans l’ordre du merveilleux, en êtres en plein mouvement qui agissent dans le sens contraire aux “dispositions “, aux “dits”, à “l’habitus” nourrissant l’homme au quotidien; et ce faisant, elle les écarte des interprétations erronées des dogmes, des formules et des lois qui les contraignent et les étouffent. Bref, elle leur dévoile une nouvelle autoperception de la violence et leur procure les moyens de s’en défendre.
Toujours est-il que chaque femme à qui Assia Djebar confère la voix et la visibilité, symbolise les femmes de tous les temps, aussi bien celles de l’Algérie comme celles d’ailleurs. Cette femme écrivaine, souvent protagoniste et parfois narratrice, représente en fait la collectivité de femmes mises en silence, maltraitées, outragées, violées et rendues invisibles dans l’histoire de l’humanité.
Par ailleurs, Assia Djebar nous livre un regard de la femme qui va au-delà de la femme algérienne des temps passés ou présents; c’est un regard qui concerne l’être humain; c’est aussi un regard sur la femme, mêlé de toute la complexité de l’individu, sans que la différence de sexe soit pertinente dans le processus de construction de soi et dans la quête inlassable de l’être humain envers le bonheur qui donne du sens à sa vie et qui définit la seule raison de l’existance humaine.
La violence assumée dans la plupart des cas signalés par l’écrivaine arrive souvent jusqu’au paroxysme de l’abus contre le droit à la vie, inné aux femmes comme à tout autre individu. Le nombre croissant de meurtres commis contre les femmes, là-bas comme ici, est une preuve irréfutable.
Dans des cas pareils, comme dans celui de la prostitution féminine ou tout autre travail forcé, ou bien indigne d’un être humain; dans les cas des salaires inégaux pour les femmes par rapport à ceux des hommes, dans les mêmes conditions professionnelles ou techniques; dans la basse participation en politique nationale ou mondiale; parmi d’autres circonstances qui impliquent les femmes, il est toujours fréquent d’entendre dire que la femme est victime et complice à la fois. Nous ne partageons pas cet avis car ce serait être, nous aussi, consentantes de la régression et de la misogynie que nous déplorons car il est certain que “la violence nous vole l’humanité”. C’est pourquoi nous invitons tous, hommes et femmes, à continuer inlassablement en quête d’une souhaitable harmonie et d’un équilibre nous conduisant à construire le collectif et à interroger notre présent, pour atteindre le bien-être et le bonheur que l’humanité mérite.
Badinter, E. (1986). L’un est l’autre. Des relations entre hommes et femmes. Paris: Éditions O. Jacob.
Bajtín, M. (1982). Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI.
Barthes, R. (1994). El susurro del lenguaje: más allá de la palabra y la escritura. Barcelona: Paidós.
Beauvoir, S. de (1987). El segundo sexo. Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte.
Borloz, V., Méndez, M. y Senior, A. (2013). Principales escritores de la Francofonía y su trayectoria literaria durante el siglo XX. Proyecto No. 023-BI-137. Universidad de Costa Rica.
Borloz, V., Méndez, M. y Senior, A. (2017). La francophonie. Texte didactique. Universidad de Costa Rica.
Bourdieu, P. (1991). Langage et pouvoir symbolique. Paris: Fayard.
Bourdieu, P. (2001). Langage et pouvoir symbolique. Paris: Seuil.
Bourdieu, P. (2001a). Science de la science et réflexivité. Paris: Raisons d’agir éditions.
Bourdieu, P. (2002). La domination masculine. Paris: Seuil.
Briana Belciug, A.M. (2014). Le status de la femme musulmane dans les écrits d’Assia Djebar.
Saarbrucken, Allemagne: Éditions Universitaires Européennes.
Calvo, Y. (1984). Literatura, mujer y sexismo. San José: Editorial Costa Rica.
Calvo, Y. (2009). La mujer víctima y cómplice. San José: Editorial Costa Rica.
Djebar, A. (1962). Les Enfants du Nouveau Monde. Paris: René Julliard.
Djebar, A. (1980). Femmes d’Alger dans leur appartement. Paris: A. Michel.
Djebar, A. (1985). L’Amour, la fantasia. Paris: A. Michel.
Djebar, A. (1991). Loin de Médine. Paris: Livre de Poche.
Djebar, A. (1995). Vaste est la prison. Paris: Livre de Poche.
Djebar, A. (1996). Le Blanc de l’Algérie. Paris: Livre de Poche.
Djebar, A. (1997). Les Nuits de Strasbourg. Paris: Babel.
Djebar, A. (1999). Ces Voix qui m’assiègent. Paris: A. Michel.
Djebar, A. (2002). La Femme sans sépulture. Paris: A. Michel.
Djebar, A. (2008). Nulle part dans la maison de mon père. Paris: Babel.
Donadey, A. (1993). “Les poétiques de subversion d’Assia Djebar”. L’Esprit créateur. Été.
Eliade, M. (1999). Historia de las creencias y las ideas religiosas. Vol. III. Madrid: Espasa.
Foucault, M. (1986). Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI.
Istarú, A. (2015). Poesía recogida. San José: Editorial Costa Rica.
Kacedali, A. (2011). Assia Djebar: une écriture du désir. Lectures croisées de L’Amour, la fantasia, Vaste est la prison, Loin de Médine, La Femme sans sépulture. Paris: Éditions Universitaires Européennes.
Kaufmann, J. (2004). L’Invention du soi: une théorie de l’identité. Paris: Hachette Littératures.
Kristeva, J. (1974). El texto de la novela. Barcelona: Editorial Lumen.
Lacan, J. (1970). Las formaciones del inconsciente. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
Lejeune, P. (1996). Le pacte autobiographique. Paris: Éditions du Seuil.
Naranjo, C. (1984). Nunca hubo alguna vez. San José: EUNED.
Ricoeur, P. (1996). Sí mismo como otro. México: Siglo XXI.
Ricoeur, P. (1996). La metáfora viva. Madrid: Trotta.
Robles, M. (1993). La metáfora del poder. México: Porrúa.
Schuré, E. (1992). Los grandes iniciados. México: Editores Mexicanos Unidos.
Vernier, F. (1974). L’Écriture et les textes: essai sur le phénomène littéraire. Paris: Éditions sociales.